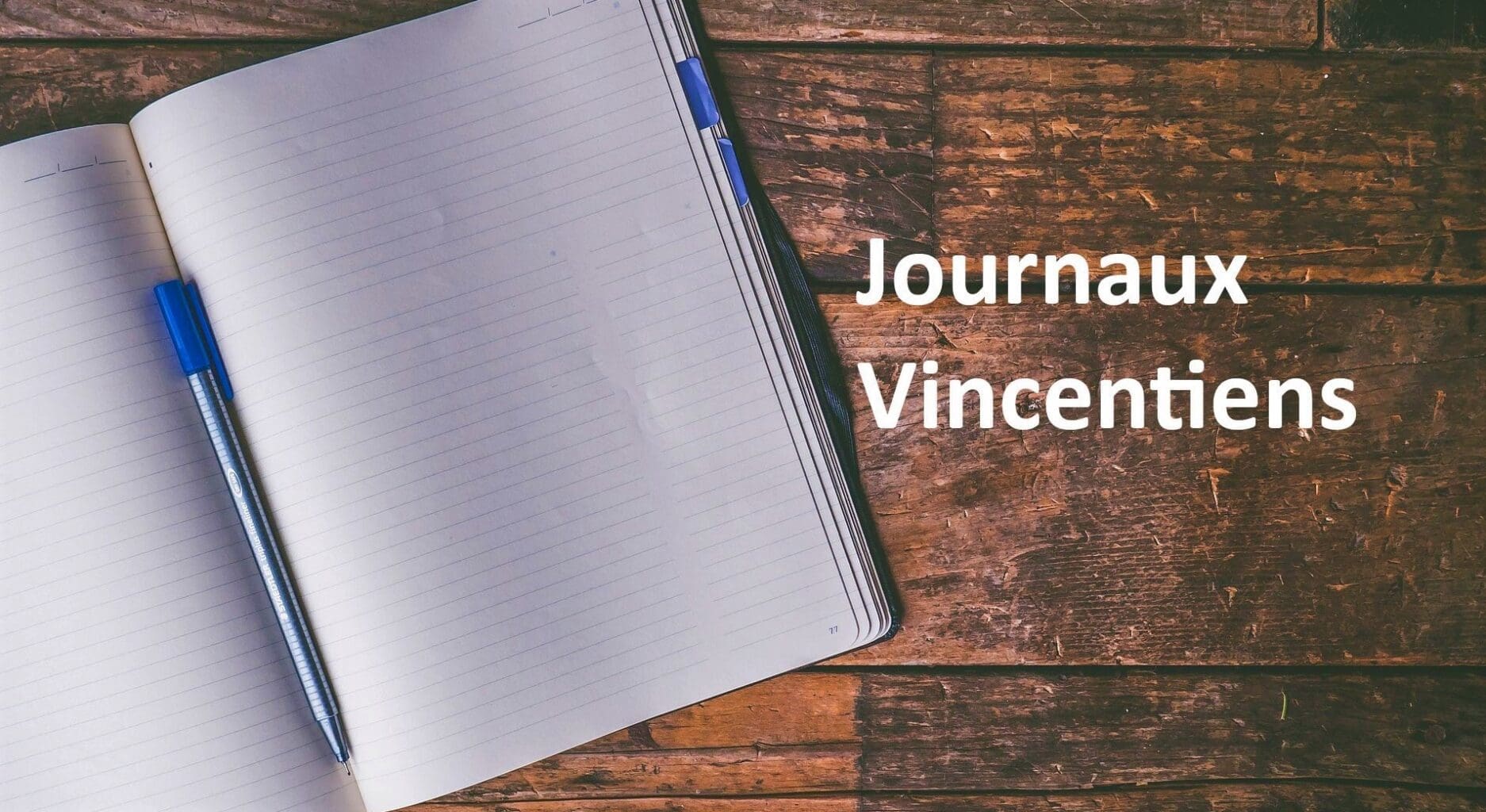
18 août 2003.
J’étais pressée entre deux urgences. Nous étions des secouristes bénévoles de la Croix-Rouge et c’était un samedi particulièrement chargé. Nous avions soigné un blessé par arme blanche. Nous l’avions emmené à l’Hôpital Général, notre centre de référence, mais nous avons dû livrer bataille pour le faire admettre, car nous ne connaissions pas son nom et aucun parent ou connaissance ne l’accompagnait pour faire tout le processus d’inscription. Nous avions à peine convaincu les infirmières de prendre soin de lui plutôt que de le laisser mourir sans surveillance dans le couloir de l’hôpital.
Mon collègue et moi sortions ensemble quand je l’ai vu. Il était allongé sur le ciment, sous une chaleur de 40 ° C, couvert de mouches et de boue … Je me suis arrêtée. Et j’ai réalisé qu’il respirait encore. « Il est ici depuis deux jours, il a supporté la pluie et le soleil. Il n’y a pas de lit pour lui. C’est un clochard », a expliqué le gardien de l’hôpital. J’ai senti mon cœur se briser. Et c’était tout ! « La Centrale nous appelle, m’a dit mon collègue. De toute façon, il va mourir. » Et nous sommes partis.
« De toute façon, il va mourir ». Bien vrai. Comme moi. Comme cet autre homme pour lequel je m’étais déplacée et dont j’avais défendu la vie face à des infirmières qui ne voulaient pas s’occuper d’un étranger. Sa vie était-elle moins importante ? Mourir dans la rue ou allongé dans la cour d’un hôpital qui a besoin du lit que vous occupez « inutilement », avec « il est un clochard » pour seule identité, c’est mourir deux fois, dans le corps et dans le reste de la dignité de celui qui est forcé de vivre dans la rue en raison de circonstances personnelles ou de structures sociales.

Photo: Kevin McShane CC BY-NC 2.0
Nous sommes partis. Nous sommes passés outre. Comme ces hommes dans cette histoire, tellement occupés par des questions importantes et des tâches urgentes. Nous avons négligé la charité parce que le devoir nous appelait.
Je ne connais pas son nom, son histoire, la fin du drame. Mais je n’ai jamais oublié la scène et, surtout, que je suis partie sans lui serrer la main, sans lui faire ressentir, en plus de la chaleur du soleil et du sol, le feu de l’amour chrétien. Ce jour-là, je n’ai pas sauvé une vie, je n’ai pas su être présence et présent pour l’autre. Ce jour-là, je ne l’ai pas aidé, mais chaque jour, il m’aide à ne pas oublier les plus pauvres et ceux qui meurent tous les jours comme des chiens …
Journaux Vincentiens examine de plus près certaines des expériences les plus personnelles des Vincentiens travaillant avec des personnes sans-abri, des habitants de taudis et des réfugiés. Ils révèlent des moments qui nous ont inspirés, des situations qui nous ont laissés sans voix et choqué, ainsi que les personnes qui ont croisé nos chemins et nous ont montré qu’il fallait en faire plus.
Ce qui les relie, c’est cet engagement vincentien envers les plus pauvres… et l’espoir qu’en tant que Famille, nous pouvons faire davantage.

Yasmine Cajuste, Responsable du développement du projet