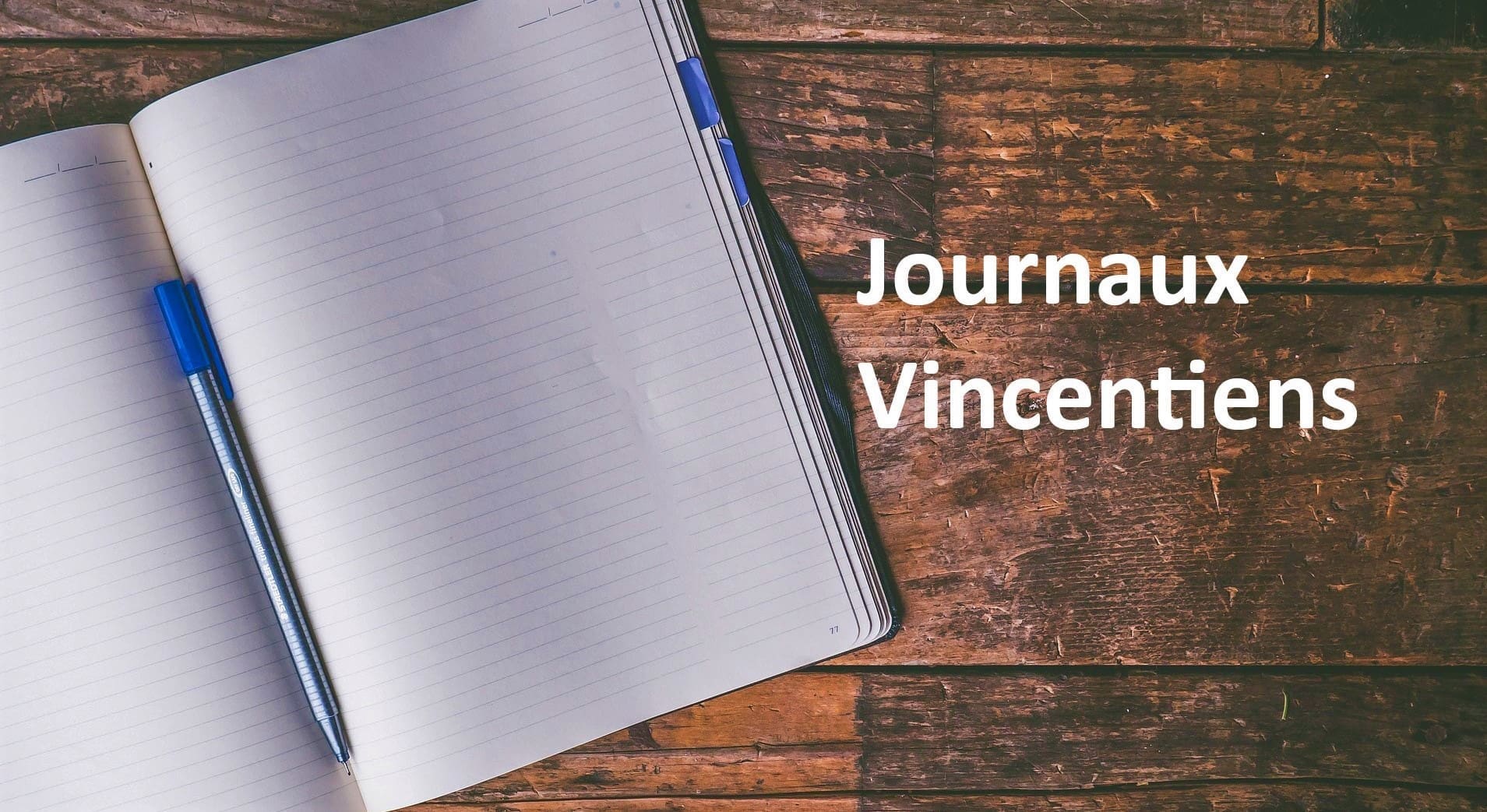 Ce qui semblait être un choix raisonnable de vêtements il y a quelques heures à peine s’est rapidement transformé en regret lorsque je me suis faufilé à travers un petit trou dans une clôture de fil de fer – en essayant de ne pas déchiqueter ma longue jupe ondulée d’été avec ses rebords dentelés ou de ne pas couper ma peau, par exemple.
Ce qui semblait être un choix raisonnable de vêtements il y a quelques heures à peine s’est rapidement transformé en regret lorsque je me suis faufilé à travers un petit trou dans une clôture de fil de fer – en essayant de ne pas déchiqueter ma longue jupe ondulée d’été avec ses rebords dentelés ou de ne pas couper ma peau, par exemple.
Une fois que nous en étions tous sortis, quelque peu peu fiers de notre acuité acrobatique, nous avons été poussés par M, ses yeux scrutant anxieusement les fenêtres des bâtiments adjacents, l’index droit au-dessus de sa bouche faisant taire notre petit groupe excité alors que nous avancions sur des sentiers envahis par les herbes qui avaient été autrefois l’accueil pavé d’un grand immeuble dominant Rijeka en Croatie.
M avait accepté de nous emmener « chez lui ». Personne ne connaît son vrai nom ni son pays d’origine. Il avait appris à être prudent au cours des dernières décennies ; ses expériences pendant l’Union Soviétique, les guerres, un compagnon stable. Il soupçonnait profondément les autorités – plutôt vivre dans la rue que de donner le secret bien gardé de son identité.

En marchant, M et moi avions opté pour l’allemand. J’ai essayé de reconstituer ce que je pouvais de son passé et de son présent, mais avec peu de succès. Il a soigneusement choisi ce qu’il allait me dire, en peignant l’image d’un homme qui, s’il n’était pas heureux, était content de sa vie, essayant de s’améliorer là où il le pouvait, mais réaliste quant aux perspectives qu’un sans-abri (qui aimait boire au-delà de la raison) obtient un emploi sur un marché du travail sans emplois. Il m’a raconté sa routine quotidienne, venir dans un centre de jour vincentien pour manger, aller au centre-ville pour mendier de l’argent aux touristes et acheter de l’alcool. Retourner chez lui après la tombée de la nuit pour tout refaire le lendemain.
Et c’est là qu’on était. Sa maison. Nous nous tenions à l’entrée ; de grandes portes doubles brisées ; du ruban jaune de police indiquant au monde entier de rester à l’extérieur, mes tongs faisant du mieux qu’elles pouvaient pour me protéger du verre qui se trouvait éparpillé sur le sol. Tandis que M manœuvrait habilement nos pas autour de meubles cassés avec des clous rouillés, des câbles grillés et des piles de saletés, j’essayais d’imaginer à quoi devait ressembler ce bâtiment autrefois. Un hall d’entrée lumineux et vitré, peut-être quelques canapés, quelques plantes ici et là, une petite communauté animée au milieu de la ville.
Si jamais il en avait été ainsi, l’immeuble ne ressemblait plus du tout à son ancien moi accueillant. Nous étions arrivés à la cage d’escalier. Ou plus exactement : le centre noir comme l’éclair avec des structures ressemblant à des marches, nous conduisant un niveau à la fois. M faisait de son mieux pour nous guider ; il connaissait son chemin par cœur, mais le reste d’entre nous – malgré les torches de nos téléphones – avançait à la vitesse d’un escargot, essayant de résister à l’envie de s’agripper à la rampe qui allait probablement se détacher au moindre contact.
M nous a dit qu’un résident avait mis le feu aux escaliers une fois, mais heureusement, personne n’avait été blessé. Nous pouvions voir les marques de brûlures sur les murs, et les cendres noires sous nos pieds, sentant sa douceur au fur et à mesure que nous marchions. Pour arriver au deuxième étage, nous avons dû nous équilibrer sur quelques planches pour avancer en toute sécurité, en essayant toujours d’utiliser la technique que M nous avait montrée. C’était le milieu de la journée, chaud, ensoleillé ; mais pour autant que nous le sachions, cela aurait pu être au milieu de la nuit. Aucune lumière naturelle ne pénétrait dans cet endroit et je ne pouvais m’empêcher de me demander comment M pouvait trouver son chemin à travers ce labyrinthe d’obstacles dangereux quand il revenait dans le noir, ivre.
Lorsque nous sommes finalement arrivés au troisième étage, nous avons été accueillis par une pile d’ordures, triste témoignage des gens y vivaient. Nous sommes tombés sur une porte cassée qui servait en quelque sorte de pont vers un long couloir. M marchait plus vite maintenant. Il s’arrêta à la troisième porte à gauche, nous indiquant l’intérieur avec un sourire timide.

Sa maison.
Ce que nous avons vu, c’était une petite pièce avec une fenêtre ouverte opposée à l’entrée. Deux vieux matelas posés sur le sol ; des draps minces et mal pliés bien placés dessus. M partageait la pièce avec un ami. Ils avaient une petite table de chevet empilée avec leurs maigres affaires – rien de valeur pour nous, mais des objets de valeur pour eux. C’était sale, puant, minable. C’était tout ce qu’il avait. Il nous avait emmenés dans son sanctuaire. Et je ne ressentais que de la gratitude parce qu’il nous faisait assez confiance pour nous ouvrir cet aspect de sa vie, pour être si vulnérable, lui un homme qui gardait tout sur ce qu’il était.
Il voulait qu’on sache comment c’était. Il voulait que nous voyions les structures décrépites et ruineuses que tant de gens ont été forcés d’appeler leur maison parce qu’il n’y avait tout simplement pas d’alternative. Il voulait que nous sachions comment il cachait tout ce qui avait de la valeur dans un tas d’ordures parce que personne ne le chercherait là. Il voulait qu’on sache pour le jeune homme qu’ils avaient trouvé mort un étage plus haut. Et l’homme que personne n’a jamais vu, mais dont ils étaient sûrs, qui vivait au dernier étage. Il a tendu la main pour nous guider à travers son monde, sa réalité. Nous l’avons prise.
Alors que nous redescendions en titubant, je n’arrivais pas à décider comment je me sentais. Ces deux dernières heures avaient laissé une impression ; elles avaient ouvert la porte à une vie – une vie qui, malgré la dureté des circonstances, s’enorgueillissait d’appeler sa maison une petite pièce délabrée au troisième étage d’un immeuble abandonné.
Et puis il y avait cet espoir qu’un jour M, un homme dans la mi-cinquantaine, peut-être – juste peut-être – pourrait vivre dans une petite maison lumineuse qui l’accueillerait dans sa sécurité, qui lui offrirait un lit avec des draps chauds et propres, un placard pour ses trésors, une petite cuisine et une salle de bain. Et sa propre porte d’entrée. Une porte sans ruban de police jaune, sans vitre brisée. Une porte qu’il pourrait ouvrir pour accueillir le monde.
Pour votre réflexion :
« Pensons-nous que nous pouvons faire ce que nous voulons sans être tenus pour responsables ? Cela n’est-il pas contraire à l’obligation que nous avons d’imiter la façon dont notre Seigneur a vécu et agi ? Il s’est toujours soumis aux autres, disant qu’il n’était pas venu sur terre pour accomplir sa volonté. Il est venu pour servir et non pour être servi. » (Sainte Louise de Marillac, T. L. de l’anglais)
Journaux Vincentiens examine de plus près certaines des expériences les plus personnelles des Vincentiens travaillant avec des personnes sans-abri, des habitants de taudis et des réfugiés. Ils révèlent des moments qui nous ont inspirés, des situations qui nous ont laissés sans voix et choqué, ainsi que les personnes qui ont croisé nos chemins et nous ont montré qu’il fallait en faire plus.
Ce qui les relie, c’est cet engagement vincentien envers les plus pauvres… et l’espoir qu’en tant que Famille, nous pouvons faire davantage.

Anja Bohnsack, Directrice de la Recherche et du Développement